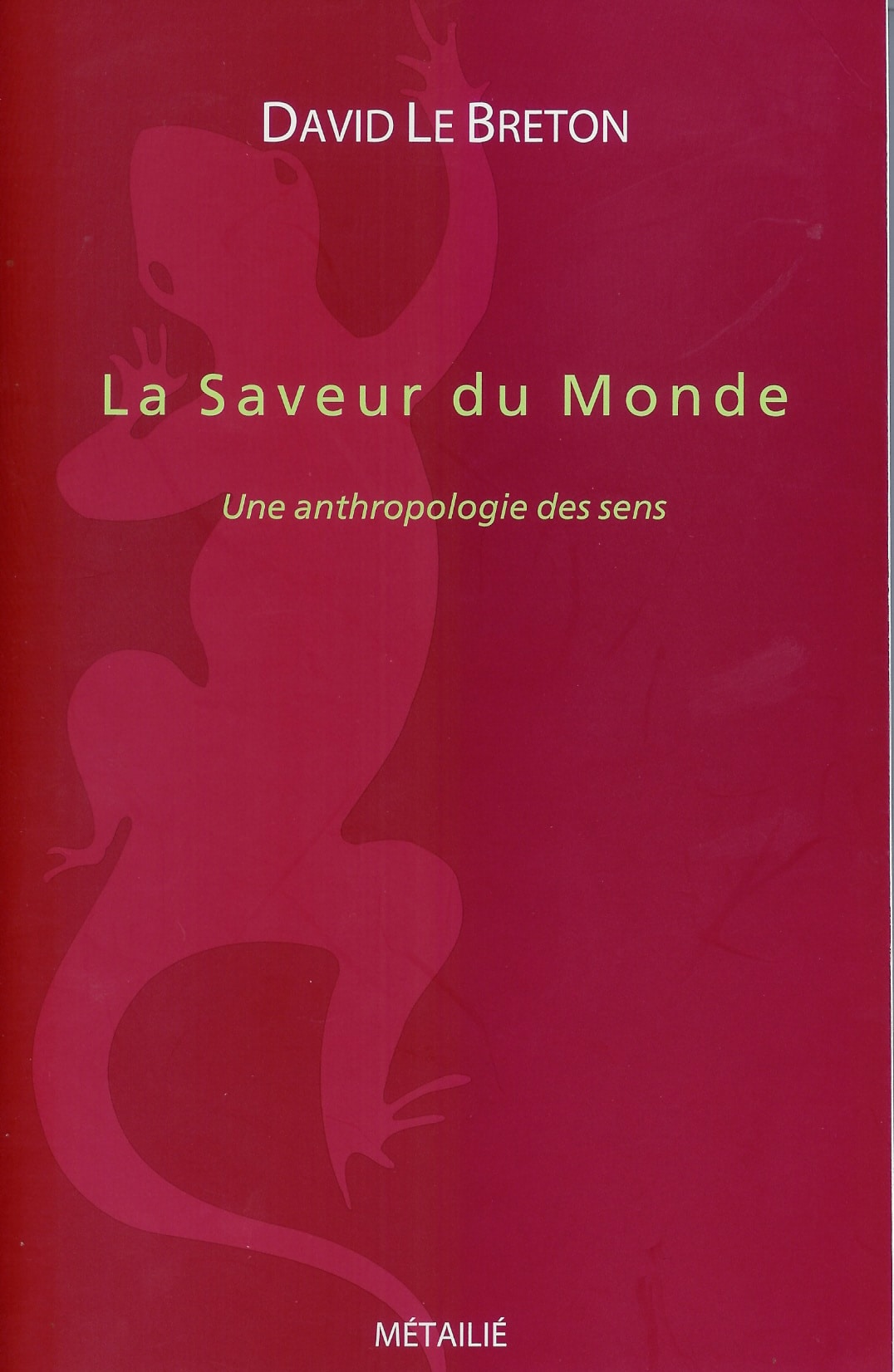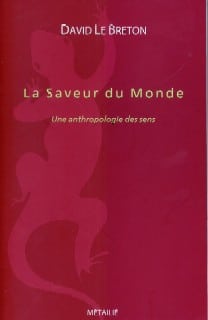 Dévorer du regard. Tendre l’oreille. Caresser l’espoir. Autant de sens mis au service de la passion humaine. Mais celle-ci fait peur au monde contemporain. La modernité, croit-on, serait devenue incompatible avec des émotions accusées de maintenir l’être humain au stade de l’animalité. On se méfie de tout ce qui pourrait remuer nos sens, nous toucher au risque d’une perte de contrôle et d’un abandon de nous-mêmes. Les circonstances, il est vrai, ne nous sont guère favorables. Dans les pays méditerranéens, reconnaître sa sensibilité est un aveu de faiblesse. En Chine ou au Japon, on porte parfois un masque pour respirer dans les grands centres urbains pollués. Ailleurs, on interdit l’écoute de la musique parce qu’elle empêcherait d’entendre la voie d’un prophète. Outre-manche, le contact corporel pour se saluer est tenu pour vulgaire.
Dévorer du regard. Tendre l’oreille. Caresser l’espoir. Autant de sens mis au service de la passion humaine. Mais celle-ci fait peur au monde contemporain. La modernité, croit-on, serait devenue incompatible avec des émotions accusées de maintenir l’être humain au stade de l’animalité. On se méfie de tout ce qui pourrait remuer nos sens, nous toucher au risque d’une perte de contrôle et d’un abandon de nous-mêmes. Les circonstances, il est vrai, ne nous sont guère favorables. Dans les pays méditerranéens, reconnaître sa sensibilité est un aveu de faiblesse. En Chine ou au Japon, on porte parfois un masque pour respirer dans les grands centres urbains pollués. Ailleurs, on interdit l’écoute de la musique parce qu’elle empêcherait d’entendre la voie d’un prophète. Outre-manche, le contact corporel pour se saluer est tenu pour vulgaire.
A tous ceux-là et aux autres, il faut recommander l’immersion salvatrice dans le dernier ouvrage de David Le Breton : « La saveur du monde ». Depuis plus de vingt ans et autant d’essais publiés sur le sujet, le corps mobilise, si l’on ose dire, tout son esprit. Cette anthropologie des sens se veut aussi celle de l’éprouvé : « Entre la chair de l’homme et celle du monde », annonce l’introduction, « pas de rupture mais une continuité ». Suivre la pensée de l’auteur revient à s’installer confortablement pour un souper fin. Les chapitres se déclinent comme un menu gastronomique où les mets de la connaissance sensorielle se succèdent et nous invitent à décoder les énigmes du vaste monde. Chaque société, nous explique ainsi David Le Breton, a construit une vision hégémonique d’un sens : L’occident privilégie la vue et l’ouie. Il en oppose la noblesse à celle du « toucher », « la condition la plus limitée des perceptions » selon des propos tenus par Kant. Mais l’histoire des civilisations, dans laquelle l’érudition reconnue de l’auteur puise de multiples références, lui offre une capacité de démenti. « Certes, reconnaît-il, la connaissance sensible manque d’universalité et de rigueur ». Mais elle « sert avec humilité au déroulement de la vie quotidienne » : elle autorise une « gustation » du monde. En fait les sens se complètent et se servent mutuellement « de caution ». Et de citer le poète allemand Goethe : « Les mains veulent voir, les yeux veulent caresser ».
Si la culture et l’éducation viennent contenir les pulsions les plus primitives, les conventions en usage, selon l’anthropologue, imposent à certains de nos sens des restrictions ou suggèrent à d’autres la nécessité de se développer. Les deux subissent, dès la naissance, un formatage social qui s’appuie sur l’extraordinaire plasticité du cerveau. Là-dessus au moins, anthropologues, neuroscientifiques et psychanalystes s’entendent. Les sens se chevauchent aisément chez l’enfant. La défaillance de l’un est palliée par le recours à l’autre : du moment que quelqu’un parle, il « fait clair pour l’enfant plongé dans la nuit », rapporte Freud dans ses Trois essais sur la théorie de la sexualité. L’enfance, il en est beaucoup question dans ce livre. Les goûts du tout petit sont imprimés d’une marque indélébile. Celle de la libido maternelle. Le désir de l’adulte n’aura de cesse de les rechercher. L’épouse aura beau suivre scrupuleusement la recette de la belle-mère, il manquera toujours au plat un petit quelque chose. Selon des études américaines citées par l’auteur, les enfants prématurés augmentent leur chance de survie s’ils peuvent écouter les battements du cœur maternel. Le bébé caressé au cours des soins parentaux, voire massé comme le recommandent les kinésithérapeutes, saura davantage restituer et faire connaître à son tour ce que Bachelard nommait « la prodigieuse forêt musculaire du creux de la main ». Malheureusement, vient nous confirmer l’auteur, le toucher en occident est « sous l’égide de l’effacement ».
Ce rapport entre la vue et le toucher donne lieu à l’évocation de l’insolite du quotidien : qui ne s’est pas trouvé dans le métro bondé aux heures de pointe ne peut se rappeler le fait connu : lorsque les corps se touchent, les regards s’évitent. C’est « l’impossibilité du toucher de l’œil qui prend le relais d’un interdit de contact effacé par les circonstances » conclut l’auteur. Renversement du scénario dans les rues de Téhéran : sous l’injonction religieuse d’un éloignement corporel, les femmes iraniennes voilées savent exploiter l’incroyable richesse lexicale du regard.
S’il ne lui consacre pas un chapitre central, peut-être par ce que l’anthropologie ne la désigne pas comme une « faculté sensorielle », David Le Breton sait reconnaître – il ne peut en être autrement compte tenu de l’usage recherché qu’il en fait – tout l’apport du langage. Même celui des signes chez ceux qui sont privés de la parole. Le mot, les psychanalystes le savent mieux que quiconque, se charge de puissance émotionnelle bien avant de véhiculer une signification. Un sens qui recouvre, en quelque sorte, tous les autres, les aide à se développer ou, au contraire, à s’altérer. Après tout, le mot se dit, s’entend, se lit et… se « couche » sur le papier.
David Le Breton, « La saveur du monde », Une anthropologie des sens, Editions Métailé, 2006, 456 p., 20 Euros.
Jlvannier@free.fr
06 16 52 55 20